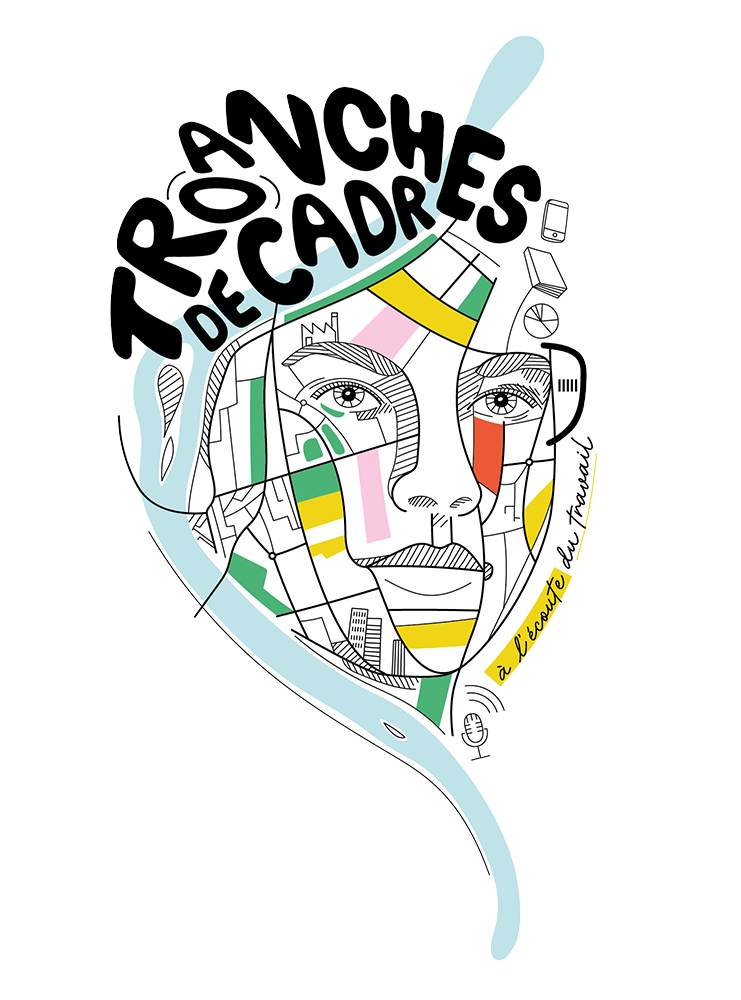[Revue Cadres] La place syndicale
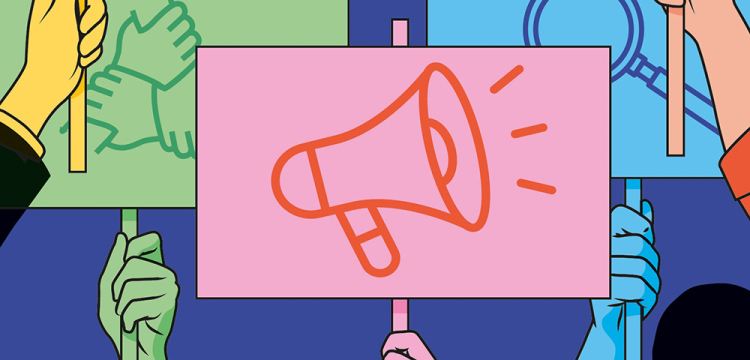
En parallèle de la parution du dernier Cadres, la revue vous propose de prendre part à son webinaire du 27 novembre, avec Syndex et Santé&Travail : « Managers au bord de la crise de nerfs ».
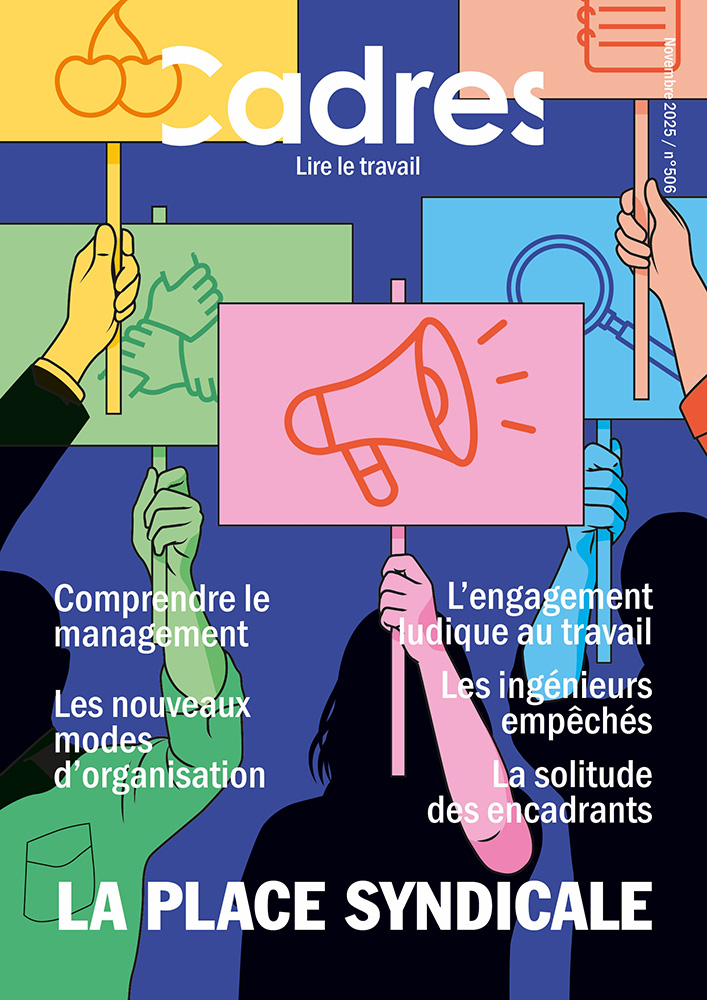 La place syndicale, Revue n°506 (Novembre 2025)
La place syndicale, Revue n°506 (Novembre 2025)
Ils font le cinq cent sixième numéro de la revue : Sabah Athmini, Jean-Paul Bouchet, Suzy Canivenc, Chloé Daviot, Christophe Deshayes, Laurent Kaufmann, Stéphane Le Lay, Marylise Léon, Aline Noël, Rémy Ponge, Laurent Tertrais, Laurence Théry, Christian Thuderoz et Karel Yon > Lire la suite
La promesse emancipative
par Laurent Tertrais, CFDT Cadres, rédacteur en chef de la revue Cadres
Alors que s'est ouverte la Conférence sur le travail et les retraites mardi 4 novembre, un rappel sur le sens du syndicalisme.
Le syndicalisme procède des grandes transformations sociales de la Révolution industrielle, avec l’émergence d’une société salariale. Les travailleurs s’organisent à l’époque pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques par territoires (bourses du travail) et par métiers (associations d’entraide)[1]. Ils en ont le droit depuis 1884, la jeune République favorisant un regroupement et la régulation de la question ouvrière. Deux grands récits donnent une perspective, l’une anarchiste et socialiste, l’autre d’impulsion catholique. Avec la charte d’Amiens et la création d’un ministère du Travail, l’année 1906 consacre le syndicalisme à la française, à distance de l’État (à la différence des pays socio-démocrates) mais tendant à unifier la société civile (à la différence des systèmes corporatistes). La fin des années 1960 avec la déconfessionnalisation et le droit à la présence syndicale dans l’entreprise - puis le recentrage dix ans plus tard - structurent un syndicalisme à la fois non partisan et ancré dans la société.
Révéler le travail invisibilisé et parcellisé
La forme syndicale traditionnelle s’articule autour de la représentation des intérêts des salariés, de l’organisation de la protection sociale et de la régulation des conflits[2] : qu’en est-il aujourd’hui ? Si le contrat à durée indéterminé et à temps plein n’est plus l’horizon directeur, la subordination en tant que contrat inégal demeure ultra majoritaire parmi les actifs et l’intensification du travail est générale. Il est cependant plus difficile de synchroniser l’adhésion avec l’emploi. Ainsi se développe un syndicalisme d’adhérents aux ressorts militants, tels des experts des conditions d’emploi et représentants des moyens de les améliorer. Masqué par les indicateurs de gestion, invisibilisé par son caractère serviciel, parcellisé ou immatériel, il est en effet essentiel de valoriser l’activité de travail, d’autant plus qu’elle engage des compétences personnelles et fait appel à une polyvalence sans cesse accrue.
« La CFDT propose aux managers et experts de tous métiers de leur donner à comprendre ce qu’ils vivent par des outils réflexifs, de transformer leurs doutes en revendications légitimes et de promouvoir un management participatif. Le développement syndical s’opère dans sa capacité à être multi-représentatif des situations de travail. »

Deuxième enjeu, celui de la redistribution des richesses. Le financement de la protection sociale prend de plein fouet la transition démographique (il y a autant d’actifs que d’inactifs). Mais il faut défendre l’octogénaire Sécurité sociale car le modèle européen, très abouti en France, est un soutien à l’économie en stabilisant la société, attirant les investisseurs et portant la consommation intérieure. D’autant plus que les inégalités et les discriminations se creusent et que les ultrariches sont tentés de faire sécession comme on le voit dans le débat fiscal actuel. Les gigantesques gains de productivité imposent de tenter de contrôler les investissements, souvent immenses et sans frontières. Aussi, un syndicalisme de gouvernance et investi dans les stratégies managériales complète l’action de redistribution et de partage de la valeur ajoutée.
Enfin, la crise des retraites a montré l’importance de l’organisation collective de la conflictualité, car si les conditions de travail sont de plus en plus individualisées, le travail, lui, est une affaire publique. Dans les entreprises et les administrations, il s’agit également d’instituer de la délibération, sur les intérêts contradictoires entre employeurs et employés ou la qualité du travail notamment. Quant à la négociation locale, récente à l’échelle de l’histoire sociale, elle suscite à la fois des attentes immenses (la palette de la qualité de vie et des conditions de travail, les sujets sociétaux comme l’impact écologique ou l’égalité…) mais a besoin de moyens. Les militants sont débordés et doutent parfois de leurs capacités à faire face[3].
C’est la fin de l’unité temps-lieu-action, celle où l’entreprise et le travail avaient leur périmètre matérialisé par des machines, des frontières et un système redistributif stable. Le décideur s’abrite souvent derrière des montages financiers, une chaîne de déresponsabilisation ou une plateforme IA. À l’heure de la quatrième révolution industrielle, la place syndicale se joue dans l’habileté à répondre à de multiples situations singulières, tout en se donnant les compétences d’investir les politiques régulatrices de la finance, de la fiscalité, de l’intelligence artificielle, de la responsabilité sociale et environnementale, des modèles et apprentissage du management, etc.
Proposer aux cadres un collectif qui comprend leurs dilemmes et leur surcharge
Que nous reste-t-il ? Du pouvoir pour édicter des normes, dans un domaine précisé et sous condition d’avoir en face un partenaire social patronal[4]. Du pouvoir d’agir en territoire sur les bassins d’emploi, de proposer l’adhésion comme soutien à la négociation obligatoire (et d’exiger que la fonction publique bénéficie d’autant de droit à négocier), d’organiser des espaces d’expression et d’échanges (section, afterwork, heures d’information, congé de formation économique et sociale, colloques, etc. ne fabriquent-ils pas une conscience partagée ?). La possibilité de faire grève et manifester dans l’espace public, car ces droits font du travailleur subordonné un citoyen à part entière. D’aller voir les milliers de petits entrepreneurs pour leur dire que nos militants n’ont pas forcément le couteau entre les dents mais sont des appuis à la performance sociale. La volonté de favoriser un syndicalisme de métier, non par corporatisme mais pour défendre les identités professionnelles. La figure du salarié protégé (car il aide les autres) illustre ce travail invisible mais nécessaire quand le quotidien déstabilise[5].
Le cadre, lui, n’est plus l’ingénieur du 19e siècle ni l’homme à l’attaché-case des Trente Glorieuses. Ni ennemi de classe, ni victime plus méritante que les autres, ni dilué dans un salariat qui s’unifierait, son statut est devenu flou car il a surtout besoin d’un collectif qui comprenne ses solitudes, ses dilemmes, ses responsabilités et sa surcharge cognitive. La CFDT propose aux managers et experts de tous métiers de leur donner à comprendre ce qu’ils vivent par des outils réflexifs, de transformer leurs doutes en revendications légitimes et de promouvoir un management participatif. Le développement syndical s’opère dans sa capacité à être multi-représentatif des situations de travail. Banalisation du forfait-jour, généralisation du télétravail, droit à la déconnexion, etc. : les exemples ne manquent pas.
En somme, le syndicalisme a toute sa place dans une société qui a peur et doute. Il est un garant du débat, de la fabrique du compromis, voire d’un récit commun autour du travail, si on ne le réduit pas à sa valeur économique mais qu’on le pense comme la démarche de chacun pour trouver sa place. Face au management toxique comme au populisme politique, le syndicalisme est un lieu où l’on prend le temps d’observer, de réfléchir et dans lequel les propositions et engagements des militants s’éprouvent par des collectifs, y compris avec des partenaires extérieurs quand cela est nécessaire. C’est cela qui manque souvent dans le travail comme dans les partis politiques. Il y a un lien entre un syndicalisme de compromis critique et un management moins hiérarchique[6]. La promesse émancipatrice ainsi élaborée exerce un certain attrait face aux tentations de l’ultra-libéralisme autoritaire, qui, parce qu’elles manipulent, nourrissent l’asservissement.
[1] Sur l’histoire du droit du travail, se plonger dans le grand récit de Jacques Le Goff, Du silence à la parole, PUR, 2019, 4e édition
[2] L’ouvrage de Pierre Rosanvallon, La question syndicale. Histoire et avenir d’une forme sociale (Calmann-Lévy, 1988) fait référence.
[3] Cf. la note CFDT-Fondation Jean-Jaurès, « La fabrique ordinaire de l’épuisement syndical », oct. 2023.
[4] Sur la place de la négociation collective, voir le pédagogique rapport Combrexelle (2015).
[5] Cf. l’excellent article de Laurent Quintreau, « Le syndicalisme ou l’art de faire tenir les mondes », Cadres n°479, déc. 2018. À lire également : Cécile Guillaume, Frédéric Rey, « Le travail syndical, un engagement » (Cadres n°500, avril 2024) sur le rapport de l’Ires, « Semer… et récolter ? Le développement syndical à la CFDT » (Cnam, 2023).
[6] Cf. les comparaisons de l’étude « European Working Conditions Survey 2024 ».
► S'abonner à la revue
[Podcast] Tronches/Tranches de cadres
Dans un monde fait d’opinions rapides, voire de jugements permanents, le principe des récits fait son chemin. Pour répondre à ces attentes alternatives de découverte et de compréhension des mondes du travail, trois collectifs, aux compétences plurielles et complémentaires, se sont réunis : la revue Cadres, l'agence Catalpa et l'association Safir.
tronchesdecadres.com/podcasts
+ d'infos
La place syndicale, Revue n°506 (Novembre 2025)
[Éditorial] La promesse émancipative (larevuecadres.fr)
Une valeur d'émancipation (larevuecadres.fr)
« Tronches de cadres », à l'écoute du travail (tronchesdecadres.com)